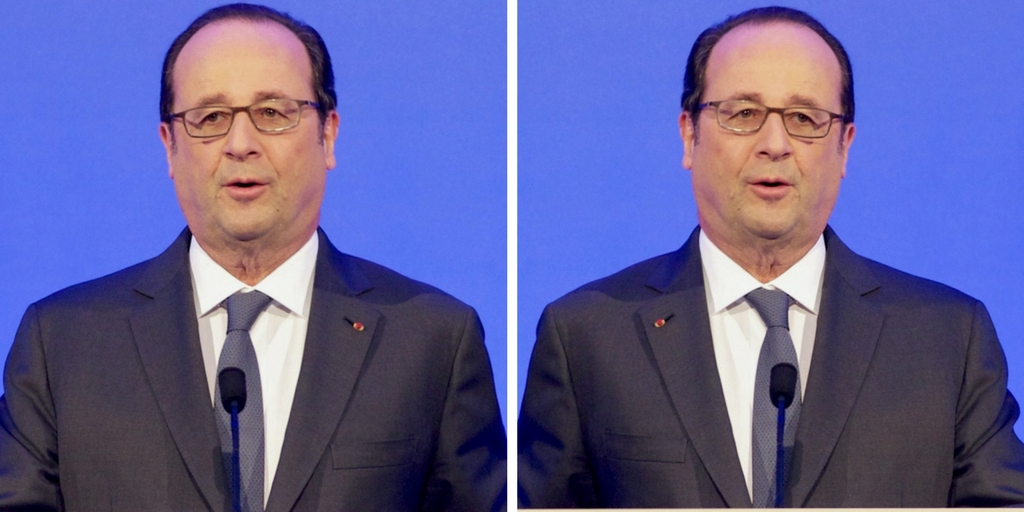Le Parti socialiste vient de se doter d’une nouvelle direction. Il est dit d’elle qu’elle est « collective ». C’est là un euphémisme sur lequel peu de commentateurs se sont arrêtés. D’où tient-on qu’autrefois cette direction n’était pas « collective ». C’est tout le contraire. Il y a toujours eu un secrétariat national, un bureau national et ce n’est pas par hasard que le titre de « secrétaire général » de la SFIO avait été transformé en « premier secrétaire » à la création du « nouveau PS » en 1971. Cela voulait dire de ce personnage qu’il était « premier parmi ses pairs ». Le rang de « premier» voulait signifier davantage l’ordre de la file que la hiérarchie. En tout cas c’était l’idée. Mais naturellement ce premier avait un rôle bien particulier et une autorité qui en résultait : entraîner la file et donc la mettre en ordre. Certains socialistes avaient même tiré la conclusion que le premier secrétaire devait nécessairement être le candidat à l’élection présidentielle. Le raisonnement était que, du jour où cela cesserait, commencerait alors une ère d’incertitude fondamentale sur le rôle et l’identité du parti lui-même.
Finalement ce n’était pas si faux. En tout cas, dire aujourd’hui que cette direction est « collective », ce n’est pas seulement défigurer le passé du PS. C’est surtout annoncer qu’il n’y a plus de « premier de cordée ». Ce n’est donc pas une concession à je ne sais quel esprit « collectif », c’est plutôt une façon de tirer l’échelle. Le PS a toujours eu une direction collective même si le collectif n’était pas toujours à l’endroit que l’on croyait. Mais elle a toujours eu une tête pour incarner ce collectif. Dire qu’il n’y a plus de tête c’est une autre manière de dire qu’il n’y a plus de collectif. Les 28 membres de ce « collectif » n’en forment pas un et il leur est impossible d’en constituer un. Et cela ne tient pas à la qualité des personnes mais à l’absence de feuille de route. Le PS n’a plus de premier de cordée pour la raison qu’il ne sait pas où il va. Je ne le dis pas en considérant ce qui lui reste d’idéologie affichée. Sur ce plan tout a déjà été dit. Je le dis parce que le PS, en parti parlementaire, qui se gargarise si fréquemment de sa vocation à « gouverner », ne peut se définir ailleurs que dans la géographie parlementaire. Et celle-ci ne connaît que deux positions : la majorité gouvernementale où l’opposition. Or, au moment décisif du vote à l’Assemblée nationale, seuls cinq députés socialistes ont voté contre la confiance. Tout le reste s’est abstenu. Ceux-là ont ainsi renoncé à se définir aux yeux de l’opinion qu’ils sont censés représenter. À moins qu’ils ne les aient trahis une nouvelle fois.
J’avais fait de cette question du vote de la confiance le « ticket d’entrée » pour ouvrir le dialogue politique que certains nous suggéraient d’avoir avec le PS. Ce point ne fut pas relevé tant il est devenu difficile aujourd’hui de percer le ronronnement moutonnier des éditorialistes. Dans ce domaine, des records ont été battus récemment. Par exemple quand que le journal Les Échos se référaient il y a encore un mois au « Front de gauche » qui a pourtant cessé d’exister depuis deux ans ! Un sommet dans ce domaine vient encore d’être atteint. En effet, quatre jours après le vote sur la confiance, le journal « Le Monde » publie une interview bilan avec Jean-Christophe Cambadelis en passant tranquillement à côté des toutes les questions sur l’identité politique du PS après le désastre.
Ainsi ne lui est-il posé une seule question sur le changement de nom du groupe parlementaire PS. Il est devenu le groupe « nouvelle gauche » abandonnant sans crier gare l’identité socialiste de sa présence ! Aucune question sur le contenu du discours de son président Olivier Faure affirmant partager les grands objectifs du gouvernement. Ni sur l’abstention du groupe parlementaire du PS dans le vote sur la confiance à Édouard Philippe. Dans la majorité ? Dans l’opposition ? Socialiste ou pas ? Telles sont les questions qui se posent concrètement. Le Monde ne s’en est pas inquiété. Une question demande pourtant « Est-il toujours possible, quand on est socialiste, de discuter avec Mélenchon ? ». On devine sans peine le contenu méprisant de la question. Et surtout, on comprend que l’alternative suggérée, c’est de discuter avec « d’autres », par exemple les macronistes. On comprend cela d’un journal qui n’a jamais reculé devant aucun moyen pour nous flétrir et dédiaboliser le Front national.
Mais s’il s’agissait d’une démarche professionnelle, et non de parti-pris hargneux, on aurait pu s’attendre à entendre demander : « Mélenchon a posé comme condition du dialogue avec vous le refus de voter la confiance au gouvernement. Que lui répondez-vous ? Le vote de votre groupe n’a-t-il pas fermé la porte à ce dialogue ? » La question ne fut pas posée. La réponse de Cambadélis a donc pu dérouler ses refrains glauques sans être interrompu : « C’est de plus en plus difficile. Il m’a l’air de filer vers le gauchisme autoritaire et le populisme le plus échevelé. » Bien sûr, les interrogateurs complaisants se gardent bien de lui demander à quel moment ce fut « facile », et à quoi Cambadélis se réfère à propos de « gauchisme autoritaire ». Le lecteur qui a payé 2,50 € pour acheter ce journal est donc invité à penser que si le dialogue est impossible ce n’est pas à cause du refus du PS de se situer dans l’opposition au gouvernement Macron mais du fait de mon « gauchisme autoritaire » et de mon « populisme échevelé » à propos desquels il ne recevra d’ailleurs aucune précision. Tel est le journalisme politique à cette heure.
Les habitudes mentales de la sphère médiatique sont tellement enkystées que la signification essentielle du macronisme, et donc du type d’opposition qu’il est contraint de recevoir, sont tout simplement ignorés. Pourtant c’est si simple ! Au-delà des circonstances, usages, et institutions évidemment différents d’un pays à l’autre, le macronisme incarne la ligne politique qui a triomphé partout en Europe : la «grande coalition» entre la droite et le PS. En France, cette coalition n’a jamais pu se réaliser sous la forme d’une alliance de partis en bonne et due forme. Cela tient au fait que le PS comme la droite étaient surplombés d’un « sur-moi », comme le disaient les commentateurs, sur sa gauche pour le PS sur sa droite pour la droite. La forme Macroniste de la «grande coalition», c’est l’amalgame, dans un parti unique assumé, des composantes de celle-ci.
« La république en marche » c’est avant tout une coalition de personnes venant de LR et du PS entouré de gens qui acceptent de les suivre. Dès lors ce qu’il reste du PS et de la droite sont promis à une dynamique permanente de dissolution sur leurs flancs. Naturellement la situation n’est pas la même pour la droite dans la mesure où ses députés restent nombreux et où son influence sur la ligne gouvernementale est totale comme le montre l’identité politique du Premier ministre venu de ses rangs. Pour le PS, effondré électoralement, sans ligne fédératrice, explosé en bataille de chefs, et surtout flanqué d’une alternative familière et attirante comme celle de «la France insoumise », la situation est bien différente. C’est pourquoi tous les responsables socialistes ont quand même trouvé un point commun. Ils psalmodient à l’unisson un mantra désormais rituel : «ni Macron ni Mélenchon» ! Mais la formule tient plus de l’exorcisme que de la ligne d’action.
«Ni Macron ni Mélenchon», on a déjà vu ce que cela donnait. C’était la ligne de Benoît Hamon en campagne présidentielle et cela n’a convaincu que 6 % des électeurs. Celui-ci persiste d’ailleurs et assume toute la logique agressive et sectaire de la formule. Il va de soi, donc, que cette orientation destructrice reçoit tous nos encouragements. Bien sûr, si Macron s’écroule, le PS ira à la plus grande facilité : le retour dans l’opposition frontale. Alors nous aurons gagné la partie. Mais si Macron ne s’écroule pas, le PS sera progressivement aspiré dans le vortex macroniste. Et cela nous permettra de travailler plus confortablement à la construction d’une alternative politique libérée des tractations avec des gens incohérents.
Je le répète donc ici : le ticket d’entrée du dialogue avec nous, c’est le passage dans l’opposition au gouvernement Macron. Naturellement, il ne s’agit pas d’une opposition sur le style, le ton, l’équilibre dans la ligne du « gagnant–gagnant » ou du « ni ni », ces trous noirs du hollandisme qui ont progressivement privé le PS de tout objectif discernable et de toute stratégie praticable. Il est clair à cette heure que le « ni Macron ni Mélenchon » montre toute la profondeur de l’enracinement du hollandisme dans les habitudes mentales des dirigeants du PS. Faute de présenter ce ticket d’entrée, il ne peut être question de « discipline républicaine » et autres supercheries telle que « vote utile », ni aucune des variantes de la « ligne Castor » où il est question de « faire barrage à… » des gens dont on reprend le reste du temps la ligne politique.
La question des alliances, des accords, des dialogues n’est donc pas posée aujourd’hui avec le PS non du fait de notre « populisme échevelé » mais parce qu’il est impossible de parler sérieusement avec quelqu’un qui ne sait ni qui il est, ni où il va. Il faut donc attendre avec patience que cette question soit tranchée par le prochain congrès de cette organisation. Et d’ici-là, il faut cependant continuer à agir et à fédérer. C’est pourquoi la main reste tendue vers tous ceux qui veulent la saisir honnêtement c’est-à-dire sans commencer par des injures ou des mises à distance ou des préalables psychologisant sur ma personne qui bloquent ensuite toute discussion.
Quoi qu’il en soit, nous continuerons à accueillir dans le cadre de « l’espace politique » de la France insoumise tous les groupements de militants qui souhaitent s’associer à notre opposition au gouvernement sur la base du programme « L’Avenir en commun ». Nous le ferons sous le label dont nous proposons l’usage en commun : « La France insoumise ». D’ores et déjà, de nombreux et fructueux dialogues ont commencé qui donneront peut-être bientôt leurs fruits. Rien ne sert de se hâter et de prendre le risque le mal se comprendre. Je sais trop combien la logique qui est celle d’un « mouvement » n’est pas dans les réflexes intellectuels ordinaires des formations de gauche qui viennent à notre rencontre. Et je ne dis pas que nous ayons nous-mêmes des réponses aussi claires que nous-mêmes nous le souhaiterions à bien des questions posées. Il faut accepter l’idée de tâtonner. Les nuques raides du virilisme politique ne sont plus de saison.